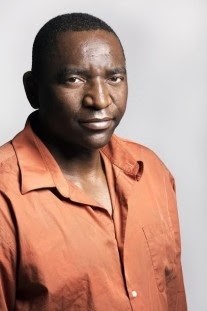(Par le Professeur Patience Kabamba)
En préambule méthodologique à ce MDW, nous rappelons que la vérité historique n’est pas un donné-là, elle est un cheminement dialectique de l’en-soi au pour-soi et au retour à soi, qui produit la compréhension du négatif. La vérité historique se produit en négatif de la mystification étatique. Il nous faut, dans un premier temps, comprendre d’une manière radicale cette mystification étatique. Au Congo, il nous est facile de dénicher cette mystification à travers un nouveau gouvernement qui défie toute logique. Le pays est divisé avec le risque de se balkaniser. Un dialogue se prépare depuis longtemps autour de la conférence des évêques catholiques et de l’église protestante. Un dialogue qui a pour but de mettre sur table les contradictions politiques entre les différentes oppositions et dissidences.
Ce dialogue est humainement et logiquement ce qui pourrait remettre le pays sur les rails d’une nouvelle mondialité congolaise. La mystification à laquelle nous assistons aujourd’hui est la sortie d’un nouveau gouvernement qui reprend les principaux acteurs politiques qui n’ont pas pu protéger le pays contre la division, qui n’ont pas pu construire une armée solide pour protéger nos frontières ; bref, les mêmes qui sont à la base de la décomposition sociale sont repris pour gouverner le même pays. La vassalisation du peuple congolais est totale. On se demande qui décide dans ce pays ? est-ce un automate central de la valeur d’échange ou des cerveaux passants ?
En fait pour mieux comprendre ce qui se passe au Congo, il faut dialectiser les conditions positives de la mystification étatique. En fait l’histoire du Congo est en écho l’histoire du monde. Les dirigeants congolais semblent ne pas prendre la mesure de la décomposition sociale et étatique, pensons-nous. Non, la vérité est qu’ils comprennent qu’ils n’ont qu’à suivre le dictat américain pour espérer conserver le pouvoir. Le pouvoir pourquoi faire ?
Rien que pour l’enrichissement personnel ; rien à avoir avec un quelconque bonheur des congolais. Le pouvoir pour le pouvoir ; c’est ce qui satisfait ceux qui ont besoin de voir les minerais importants du Congo atteindre le marché mondial sans discontinuer.
Mais, les Américains, ou les Rwandais ne voient-ils pas des congolais mourir de faim alors qu’ils possèdent des terres arables, des congolaises se faire violer alors qu’elles ont une armée nationale ; des Congolais s’exiler alors qu’ils possèdent un grand et beau pays ? Les américains ou les arabes observent bien une décomposition sociale en RDC, et en vérité eux non plus ne dirigent rien ; ils sont tous sous le dictat du capital. L’esclavages et la colonisation avaient pour but de lutter contre la baisse taux du profit du capitalisme naissant en occident.
Lorsque nous parlons du capitalisme, il ne faut pas seulement voir la brutalité avec laquelle la valeur d’échange s’impose sur la valeur d’usage, mais il faut aussi voir une aliénation de l’homme. Nous n’avons pas le droit de produire ce que nous voulons. La situation objective nous impose d’investir dans la guerre plutôt que dans des écoles ou dans la recherche. Dans ce MDW, je voudrais prendre l’exemple du travail pour montrer comment nous adhérons aux dogmes capitalistes comme nous le faisons en religion. Qui nous oblige à accepter cette définition du travail ?
La maman qui prépare de la nourriture pour entretenir la vie de sa famille ne travaille pas, disons-nous. Mes étudiants disent même que maman reste à la maison et ne travaille pas. La maman qui fait la même chose dans un restaurant ; elle prépare la même nourriture pour les clients du restaurant dont elle n’est pas la propriétaire ; celle-là travaille parce qu’est génère de la valeur économique.
Dans le capitalisme travailler c’est être capable de produire une valeur économique ; une valeur d’échange. Maman qui prépare à la maison produit de la valeur d’usage ; le repas que nous allons manger à table comme diner. Cette valeur d’usage ne compte pas pour le capitalisme. Maman peut passer quatre à cinq heures en train de préparer, de faire les lits pour les dix personnes qui habitent chez elle, elle ne travaille pas.
Elle produit tout simplement de la valeur d’usage, qui n’est pas une valeur économique. Les Nations Unies et toutes les institutions capitalistes mondiales nous font croire que la valeur d’usage n’est pas liée au process de travail. Pour le FMI, les enseignants ne travaillent pas parce qu’ils produisent de valeurs non-marchandes.
C’est cette définition du travail que la classe dominante contrôle et impose. Le cœur de la puissance de la classe dominante c’est le contrôle du travail, de la définition de ce qui a valeur et de ce qui n’a pas de valeur économique. Pour produire de la valeur économique il faut s’endetter auprès des banques ou de préteurs à gage afin d’ouvrir son restaurant. La classe dominante tient absolument à imposer sa puissance sur le travail.
Le second dogme capitaliste que nous avons accepté est que la création monétaire se fait toujours à crédit. Si je veux ouvrir un restaurant, je dois aller emprunter de l’argent et rembourser par la suite. Je vais donc travailler pour rembourser une dette.
Cependant, lorsque vous allez à la banque emprunter de l’argent, cet argent n’existait pas la seconde avant votre demande. La banque crée de l’argent à partir de rien. C’est l’écriture qui crée l’argent qu’on vous prête. Sur votre compte on a mis 5000$.
Mis cet argent n’avait pas existait la seconde d’avant. C’est lorsque vous allez rembourser cet argent que l’on effacera les écritures qui ont créées cette monnaie. Dans le capitalisme, on est endetté avant même de travailler. La maman qui travaille au restaurant le fait pour rembourser une dette ; la dette que l’on a contracte pour ouvrir le restaurant. Voilà le dogme capitaliste.
Cependant, il y a des fissures que nous pourrions exploiter. Le professeur émérite de l’université est payé même sans aller à la fac. Son salaire n’est pas consécutif à un acte économique précis. Dans le capitalisme, ne travaille que celui qui produit un acte qui met en valeur le capital ; le salaire est donc le prix de la force du travail. Ceci est une manière de regarder le monde. Le travail peut être ce que fait le professeur émérite.
Il nous faut libérer le travail et le salaire de leur contexte capitaliste. L’alternative est de comprendre le travail comme une activité faite par des humains qui produisent ce qui est socialement utile et qui devrait s’insérer dans la dynamique du vivant et humain et non-humain. Les travailleurs doivent donc prendre le pouvoir sur le contenu du travail. L’argent proviendra des subventions et non des dettes. L’UPN fait peau neuve parce qu’une subvention étatique et non un emprunt a été octroyée pour cela.
Enfin, le salaire est un droit comme le droit de vote, ce droit est lié à la citoyenneté et non à la nationalité. La citoyenneté est relative à la résidence et non à la nationalité. Le salaire n’est pas consécutif à un acte économique posé, mais en tant que droit, il vient avant tout activité.
Tout citoyen qui atteint l’âge de la majorité a droit à trois choses :
a) un salaire quel que soit ce qu’il fait ;
b) à la propriété patrimoniale d’usage ; il est propriétaire des moyens de production mis à sa disposition, comme l’UPN rénovée.
C) il décide de la création monétaire par subvention selon les besoins locaux.
Voilà ce qu’il faut pour se sortir du piège capitaliste et de la domestication par le travail. Les mystifications étatiques que nous vivons au Congo ne s’arrêteront qu’à ce prix de la lutte de classes d’une intensité rad