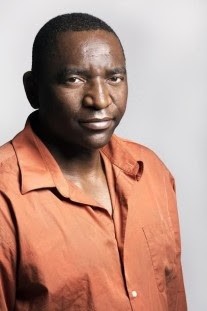(Par le Prof. Patience Kabamba)
Le MDW de cette semaine sera consacré à l’élection de Zohran Mamdani, premier maire musulman de la ville de New York. Il serait particulièrement pertinent d’examiner le programme sur la base duquel il a été élu, incluant notamment le gel des loyers à New York, la gratuité des transports publics et de la garde d’enfants, ensemble de mesures qu’il caractérise lui-même de « socialistes ».
Dans les pages subséquentes, il sera question de l’influence familiale exercée sur Zohran, des strates de la population ayant appuyé son élection, et enfin de la notion de socialisme à laquelle le nouveau maire adhère.
1. Une famille intellectuelle de renommée mondiale.
Zohran est le fils de Mira Nair, cinéaste d’origine hindoue et de notoriété internationale. Elle fut un temps envisagée pour la direction de la série Harry Potter. Et de Mahmood Mamdani, l’un de mes professeurs et mentors à l’université Columbia, à New York. Zohran a hérité, entre autres attributs, de la capacité de communication perspicace de son père. Cependant, il convient de s’interroger sur l’identité de Mahmood Mamdani, un intellectuel remarquable dont l’œuvre a profondément marqué son époque à travers trois contributions majeures, à savoir « Citizens and subjects » (1996), « When the victims become killers » (2001) et « Good Muslim, Bad Muslim » (2004).
Dans « Citizen and Subjects », Mamdani avance que le mode de pensée colonial a persisté au-delà des indépendances. En Afrique, une distinction était établie entre les populations urbaines, régies par le code civil, et les populations rurales, soumises au droit coutumier dans les bantoustans. De surcroît, cette dichotomie entre modernité et tradition continue de structurer les inégalités politiques et sociales sur le continent africain. Selon Mamdani, les discours sur la liberté masquent en réalité une logique de domination coloniale. Selon Mamdani toujours, la violence sociale observée en Afrique résulte d’une contamination de l’État civil moderne par la société traditionnelle, elle-même dominée par un despotisme décentralisé. Au lieu d’attribuer exclusivement la violence politique en Afrique à la colonisation, François Bayart avance que la violence en Afrique possède des fondements autochtones robustes, c’est-à-dire ancrés dans l’historicité des sociétés africaines elles-mêmes. Les deux analyses, celle de Mamdani qui attribue à la colonisation l’origine de la violence politique en Afrique et celle de Bayart qui situe les violences africaines dans le socle historique des sociétés africaines, s’avèrent toutes deux pertinentes. La violence se manifeste dans toutes les sociétés. La divergence réside dans l’approche adoptée pour sa gestion. Le colonialisme a instauré une modalité spécifique de gestion des violences préexistantes. La hiérarchie revêt une importance capitale en ce qu’elle permet de réguler les manifestations de violence sociale. Mamdani, Mbembe et Bayard présentent des perspectives distinctes qui, malgré des apparences initiales de contradiction, s’avèrent toutes pertinentes.
Dans son ouvrage intitulé « When Victims become Killers », Mamdani maintient la même lucidité en rejetant une interprétation culturaliste et moralisatrice du génocide rwandais. Il décèle les prémices du génocide dans la répartition coloniale distinguant les Hutus, affectés aux cultures agricoles, des Tutsis, employés dans les écoles en tant qu’auxiliaires des colons allemands. La classification en Hutu, Tutsi et Twa, initialement constituée d’échelons fonctionnels déterminés par la possession de plus ou moins de dix vaches (respectivement Tutsi ou Hutu), s’est transformée en une division raciale suite à l’inscription coloniale. Le génocide représente pour lui l’émanation logique d’une domination coloniale qui a naturalisé, voire racialisé, les différences. Une fois de plus, Mamdani présente les Africains comme des victimes dépourvues de la capacité d’agir face à une structuration sociale imposée par des acteurs extérieurs. Résidant en République Démocratique du Congo, où je suis témoin d’une gabegie financière considérable soixante ans après l’indépendance, je me permets de mettre en doute cette interprétation de l’histoire africaine.
En dernier lieu, dans « Good Muslim, Bad Muslim », Mamdani souligne que cette distinction ne relève d’aucune considération religieuse et qu’elle est, de fait, strictement géopolitique. L’adhésion aux préceptes de l’Occident conditionnerait la qualité de musulman, tandis que la contestation de cet ordre établirait un statut défavorable. En définitive, Mamdani réfute l’interprétation culturelle de la violence politique avancée par l’Occident. Il propose de réinvestir le champ politique de la violence qui s’exerce à l’encontre de ceux qui prétendent incarner la raison, et qui tendent à la « culturaliser ».
L’œuvre de Mamdani constitue, de facto, une interpellation continue de l’anamnèse coloniale. Il est impératif de retrouver cette politique identitaire, laquelle a été phagocytée par la domination coloniale, et de continuer à exposer ses continuités sous les métamorphoses modernes de liberté et de raison.
La distinction manifeste entre Mahmood et Zohran réside dans le fait que le premier, le père, s’inscrit dans une politique identitaire dénoncée comme une construction impériale, tandis que le second, le fils, se positionne dans l’économie politique au-delà de la politique identitaire paternelle, laquelle aurait occulté l’histoire classique de l’économie politique telle que conceptualisée par Marx. La politique identitaire n’a jamais induit une remise en question de la valeur d’échange, comme le suggère l’aisance financière dont ont bénéficié les Mamdani, contrastant avec les difficultés économiques rencontrées par la majorité de la population mondiale. Confronté à la déshumanisation capitaliste en Amérique, et plus précisément à New York, Zohran a pris conscience que le véritable enjeu ne réside pas dans les questions identitaires, mais dans l’abolition de l’organisation capitaliste du monde, du travail et du salariat. Il s’agit, à mon sens, du point de démarcation entre les deux générations.
2. La question de l’identité des électeurs ayant voté pour Mamdani à New York se pose.
Hier, l’élection d’un maire de confession musulmane et d’ascendance indo-ougandaise s’est produite pour la première fois à New York. Zohran Mamdani, âgé de trente-quatre ans. Quelle est la justification d’élire un musulman dans une municipalité où la population juive exerce une influence prépondérante depuis plusieurs décennies ? Mamdani se déclare socialiste dans le but de transformer les modes de vie à New York. La composition démographique de l’électorat ayant voté pour Mamdani est principalement constituée de diplômés universitaires, de professeurs, d’avocats, ou d’individus ayant reçu une éducation dans de grandes universités. Ils partagent une caractéristique commune : en dépit de leur niveau d’études, ils vivent dans la précarité au cœur de New York. Le manque de ressources alimentaires, l’insuffisance d’espace vital et l’indigence des moyens nécessaires à l’éducation de leur progéniture illustrent leur victimisation par une organisation capitaliste du monde. Mamdani expose un programme politique socialiste. C’est ce phénomène qui a captivé ces intellectuels désargentés. À défaut d’une mobilisation, la même configuration sociale appauvrissante sera léguée aux générations futures.
3. Le socialisme fait-il l’objet d’une interrogation ?
Il est à noter qu’une confusion certaine persiste chez de nombreuses personnes concernant les concepts de socialisme et de communisme. Cette confusion était déjà manifeste à l’époque de la rédaction du Capital par Marx, entre 1858 et 1868. À l’encontre de la perception commune, le socialisme ne constitue pas une étape préliminaire au communisme, mais plutôt une antithèse de ce dernier. Il convient de souligner que le socialisme et le capitalisme se fondent sur l’aliénation du travail. Le socialisme se présente comme une modalité du capitalisme dont la caractéristique prédominante réside dans l’aliénation du travail, c’est-à-dire la dépossession du travailleur du fruit de son activité. Le communisme se définit comme l’appropriation par les travailleurs des moyens de production. Il existe un système de contradiction inhérent au capitalisme, contrairement aux assertions de Lassalle (1825) et de Lénine. Il s’ensuit donc que le communisme constitue le mouvement effectif visant à dépasser le capitalisme (Marx, Idéologie allemande). Il s’agit d’une tentative de désaliénation entreprise à l’échelle de la base. En régime communiste, les fonctionnaires s’organisent de facto pour s’approprier leurs salaires en tant que droit personnel, exercer un droit d’usage sur les moyens de production, et détenir un droit patrimonial sur les biens de production. Le communisme se manifeste lorsque des groupements s’organisent dans le but d’assumer la responsabilité du collectif, notamment en ce qui concerne la subsistance, l’éducation des enfants, y compris les crèches, la santé, la sécurité et la culture.
Cependant, quelle est l’origine de la confusion avec le socialisme ? Il convient de la positionner au milieu du dix-neuvième siècle. En réalité, un différend a manifestement opposé Lassalle, responsable de l’organisation des travailleurs allemands, à Marx et Engels. Selon Lassalle, l’avènement du communisme ne pouvait se réaliser à partir du capitalisme, ce dernier étant appréhendé comme un système clos. Il a élaboré une théorie sur l’avènement du communisme, postulant qu’il résulterait d’un processus initié par une victoire électorale du parti ouvrier. Il est donc envisagé que ce parti prenne la direction de l’État, instaure le socialisme, puis, ultérieurement, mette en place le communisme. Le schéma proposé par Lassalle se déroule comme suit : une victoire électorale initiale est suivie d’une phase socialiste, laquelle aboutit finalement au communisme. Il s’agit en réalité de ce que l’on désigne sous le terme de social-démocratie. Elle vise à rectifier les effets délétères du capitalisme, afin de promouvoir un capitalisme plus social. L’expérience historique a malheureusement démontré l’impossibilité de cette éventualité. En effet, le contrôle du travail demeure une prérogative de la bourgeoisie, laquelle détermine les critères de valeur et de non-valeur. Il est possible d’inférer, d’un point de vue pragmatique, que le socialisme favorise l’avènement du capitalisme. Il s’agit de son cousin germain, et non de son opposé. Il a toujours été observé que le capitalisme finit par reprendre le contrôle de la société dans les régimes sociaux-démocrates. Au sein du socialisme, et plus particulièrement dans sa déclinaison proudhonienne telle qu’elle est présentée par Mamdani, on observe une méconnaissance du fait que la monnaie ne constitue pas uniquement un instrument de mesure ou un système d’échange, mais avant tout une relation de domination. Les propriétaires s’efforcent de préserver cette relation. Ils ne sont même pas engagés dans un conflit pour des motifs financiers, mais plutôt pour acquérir la capacité de déterminer la nature du travail, l’ascendant sur le travail.
Une autre perspective du socialisme est incarnée par Lénine. À l’instar de la social-démocratie allemande, Lénine considérait qu’il était nécessaire, dans un premier temps, de s’emparer du pouvoir étatique, d’instaurer le socialisme (à l’exemple des républiques socialistes soviétiques – URSS), puis d’établir le communisme. Selon Lassalle et Lénine, l’instauration du communisme à partir du capitalisme se révèle impossible, ce dernier étant appréhendé comme un système clos. Par conséquent, il est impératif, dans un premier temps, de s’emparer du pouvoir, soit par la voie électorale, soit par un processus révolutionnaire tel que celui observé en octobre 1917. L’analyse de l’évolution historique met en évidence que le capitalisme s’est initialement accommodé de la social-démocratie, avant de progressivement reprendre le contrôle. Le capitalisme se révèle capable de tolérer des approches qui présentent des contradictions internes ou qui s’opposent à ses principes. La social-démocratie a finalement été supplantée par le capitalisme, tant en Allemagne qu’ailleurs. Lénine a instauré une dictature inédite, tout en procédant à l’élimination physique de communistes authentiques. Il convient de se souvenir des marins de Cronstadt qui ont été tués le 29 février 1921. Marx avait anticipé ce genre de dérives vers la violence. Par conséquent, il a déclaré à cette fin que « ce que je sais, c’est que je ne suis pas marxiste ».
Contrairement à Lassalle, et par conséquent à Lénine, Marx et Engels avançaient que le capitalisme constitue un mode de production intrinsèquement contradictoire. Il recèle en son sein des prémices du communisme. Il est impératif de restituer aux travailleurs la maîtrise de leur activité professionnelle, depuis sa conception jusqu’à sa réalisation. Il s’agit de l’unique approche qui soit adéquate pour les habitants de New York. La rémunération demeure un droit inaliénable de l’individu, indépendamment de la nature de son activité. Le communisme se manifeste de ce fait comme une organisation constituée par le collectif en vue de s’affranchir des écueils capitalistes. Le principe de productivité ne saurait constituer à lui seul la totalité de l’être humain. Il est inadmissible, contrairement aux impératifs du capitalisme contemporain, d’indexer l’intégralité de la nature humaine sur le seul principe de rendement. L’intégralité de notre organisation humaine ne se limite pas à des considérations mercantiles. Tandis que le socialisme, qu’il s’agisse de social-démocratie ou de marxisme-léninisme, consolide le capitalisme, le communisme représente l’ensemble des efforts déployés dans notre existence concrète pour s’affranchir de ce système aliénant. Au-delà d’un simple système de production, le capitalisme se manifeste comme un mode de pensée, un esprit et une rationalité singulière, intrinsèquement orientés vers la satisfaction d’une quête de profits insatiable. Afin de le contrer, une organisation collective s’avère nécessaire. La revendication d’un logement décent, de transports adéquats et de garderies gratuites ne saurait être considérée comme radicale, hormis dans un système capitaliste où l’ensemble des structures repose sur des considérations financières. Il serait donc suggéré à Mamdani de dépasser le socialisme, souvent perçu comme un capitalisme déguisé, et d’adhérer plutôt au communisme, système dans lequel les individus exerceraient un contrôle sur les structures déterminant leur existence.