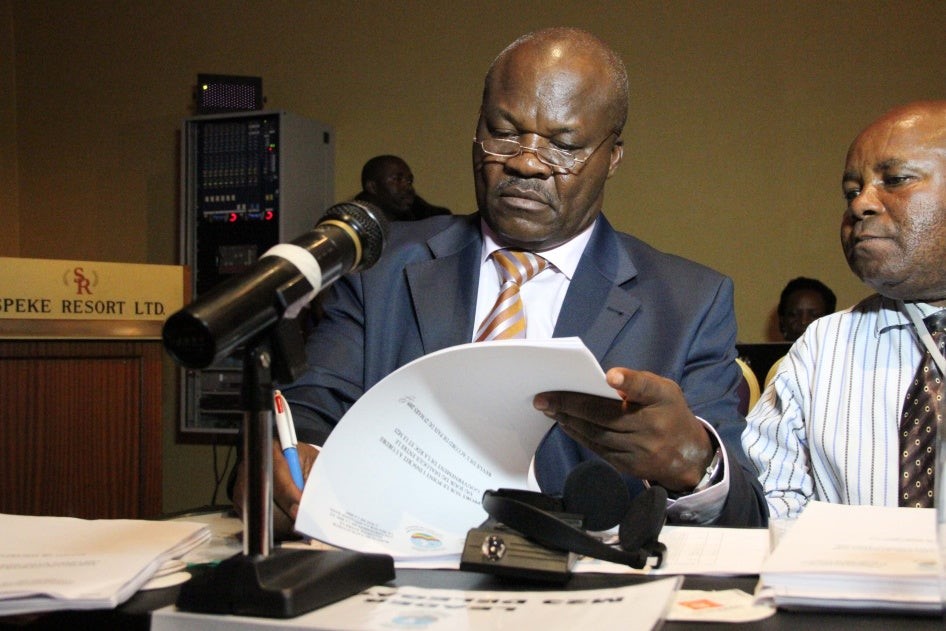(Par Maître Guy-Patrick Kiba – Expert en droits humains, en droit constitutionnel et analyste en gouvernance démocratique)
I. Un chemin de crête entre idéal et réalités
L’annonce de convocations de hautes personnalités congolaises, Jean-Pierre Bemba et Constant Ndima, devant des juridictions étrangères au titre de la compétence universelle, a suscité autant d’espoir que de confusion. Si ce principe juridique incarne un idéal de justice sans frontières, sa mise en œuvre est un chemin de crête, semé d’obstacles procéduraux et de barrières diplomatiques. Loin d’être une procédure d’ouverture illimitée, la compétence universelle est un instrument de précision, dont le succès dépend du respect de conditions strictes et de la levée préalable des immunités.
II. La compétence universelle : un principe, aux applications variables
La France, l’Espagne et la Belgique sont souvent citées comme les fers de lance de cette justice. Pourtant, leurs législations nationales divergent sensiblement, créant un paysage judiciaire européen fragmenté.
En Belgique, berceau de lois ambitieuses, le législateur a considérablement restreint le champ d’application de la compétence universelle après des pressions diplomatiques. Aujourd’hui, la loi exige généralement un « lien de connexion » substantiel. La procédure ne peut être engagée que si la victime ou la personne poursuivie est belge, réside en Belgique, ou si l’auteur présumé des crimes se trouve sur le territoire belge. Cette condition est un filtre crucial qui empêche des poursuites purement théoriques.
En France, le code de procédure pénale est tout aussi restrictif. Le parquet ne peut saisir la justice au titre de la compétence universelle que si l’auteur présumé des crimes se trouve en France. La présence de l’individu sur le territoire national est une condition sine qua non pour l’ouverture d’une information judiciaire.
L’Espagne, après une période d’extrême activisme judiciaire, symbolisée par la tentative de poursuite contre l’ex-secrétaire d’État américain Henry Kissinger, a également révisé sa loi. Désormais, la compétence universelle n’est activée qu’en l’absence de poursuites dans le pays où les crimes ont été commis, et surtout, si les victimes ont un lien avec l’Espagne ou que l’auteur présumé s’y trouve.
Ainsi, dans chaque cas, l’idée d’une justice « tous azimuts » cède le pas à une logique de « lien raisonnable ». Une convocation, comme c’est le cas pour MM. Bemba et Ndima, ne signifie en rien qu’ils sont considérés comme prévenus ou suspects ; ils peuvent parfaitement être entendus en qualité de témoins. Le vrai test commence lorsque l’on cherche à transformer cette convocation en mise en accusation.
III. Le mur des immunités : l’ombre portée de l’affaire Yerodia
Au-delà des conditions de saisine, un obstacle bien plus redoutable se dresse : l’immunité des membres de gouvernement en exercice. C’est ici que la qualité de vice-Premier ministre de Jean-Pierre Bemba devient un élément juridique central.
Le droit international coutumier est clair, et la Cour internationale de Justice (CIJ) l’a rappelé avec force dans l’affaire du Mandat d’arrêt du 14 février 2002 (RDC c. Belgique), dite « affaire Yerodia ». Dans cette affaire, la Belgique avait émis un mandat d’arrêt contre le ministre des Affaires étrangères congolais de l’époque, Abdulaye Yerodia Ndombasi. La CIJ a statué que les ministres des Affaires étrangères en exercice – et par extension, les hauts responsables gouvernementaux – bénéficient d’une immunité de juridiction pénale absolue devant les juridictions nationales étrangères. Cette immunité vise à garantir le bon fonctionnement des relations internationales et s’applique même pour des crimes internationaux graves, comme les crimes de guerre ou les crimes contre l’humanité.
Par conséquent, tant que Jean-Pierre Bemba occupe ses fonctions de vice-Premier ministre, toute tentative de le poursuivre personnellement devant un tribunal belge, français ou espagnol se heurterait très probablement à cette immunité, et serait contraire au droit international. La CIJ l’a affirmé sans ambiguïté : la compétence universelle ne peut s’exercer au mépris des immunités coutumières.
IV. Un idéal de justice tempéré par la réalité du droit
La compétence universelle reste un outil précieux dans l’arsenal de la lutte contre l’impunité. Elle constitue une épée de Damoclès pour les auteurs de crimes atroces et une lueur d’espoir pour les victimes. Cependant, son invocation dans des affaires aussi sensibles politiquement que celle impliquant des membres éminents d’un gouvernement en exercice nous rappelle ses limites intrinsèques.
Entre les conditions de saisine variables selon les États et le mur des immunités érigé par la Cour internationale de Justice, la route vers un procès est étroite. Ces garde-fous, aussi frustrants soient-ils pour les partisans d’une justice immédiate, sont le prix de la stabilité du système international. Ils nous rappellent que la justice, même universelle, doit composer avec la souveraineté des Etats et la complexité des relations diplomatiques. L’appel à comparaître n’est que le premier pas d’un long et périlleux parcours judiciaire.